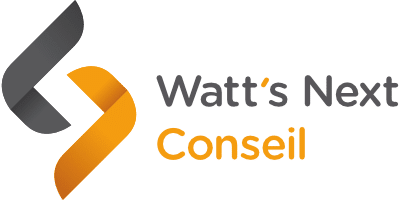Le nouvel âge d’or des centrales gaz

Une longue traversée du désert pour les projets de centrales gaz
La décennie 2000-2010 a été une période prolifique pour les centrales gaz. A la faveur de l’ouverture à la concurrence, les gaziers sont devenus électriciens et inversement. Point de convergence des deux mondes : les centrales gaz à cycle combiné. Ces infrastructures se sont alors multipliées partout en Europe. Sur les 13 cycles combinés actuellement en service en France, six ont été mis en service et la construction de six autres a débuté pendant cette période. Puis le contexte a complètement changé et une longue traversée du désert a commencé. Les nouveaux projets se sont raréfiés. D’abord, il y a eu la crise de la missing money qui a frappé le secteur de plein fouet dans la décennie 2010.
Les centrales gaz ont peu fonctionné pendant plusieurs années à cause de prix de gros trop bas contraignant de nombreux exploitants à fermer ou mettre sous cocon une partie de leurs centrales gaz. Les ambitions européennes en matière de décarbonation ont ensuite presque exclusivement orienté les investissements vers la production d’électricité renouvelable. L’objectif de neutralité carbone de l’UE pour 2050 exclut d’ailleurs, plus largement, le gaz naturel du mix énergétique.
Alors, est-ce la fin des centrales gaz ? Certainement pas, les centrales gaz existantes demeurent indispensables pour assurer l’équilibre des systèmes électriques européens à l’heure actuelle. Et plusieurs pays européens ont même des programmes de développement ambitieux.
Un foisonnement de nouveaux projets de centrales gaz
Trois pays illustrent ce retour en grâce des centrales gaz : l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni. L’augmentation de la production d’électricité renouvelable irrégulière issue de l’éolien et du photovoltaïque met sous pression la stabilité de leur réseau (tout comme dans les autres pays européens d’ailleurs). D’autant que leurs moyens de production pilotables diminuent. Le Royaume-Uni est sorti du charbon en 2024 et un retrait du charbon est également engagé en Allemagne et en Pologne. L’Allemagne de son côté est sortie du nucléaire en 2023. Ces trois pays ont, en outre, peu de capacités de production hydroélectrique en raison de leur géographie inadaptée.
Ils misent donc tous les trois sur de nouvelles centrales gaz. L’Allemagne a ainsi annoncé un programme pour construire 20 GW d’ici 2030. Pour respecter son objectif de neutralité carbone en 2045, l’Allemagne compte sur la conversion à l’hydrogène de ces centrales et/ou au captage du CO2 d’ici là. Plusieurs centrales sont ainsi en projet à l’heure actuelle. RWE, par exemple, prévoit 3 GW d’ici 2030.
Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé en juillet 2025 vouloir disposer d’au moins 40 GW de capacité de réserve d’ici 2040 ce qui ouvre la porte à de nouvelles centrales gaz. Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours. SSE a, par exemple, trois projets (Platin, Ferrybridge, Keadby 3), plus ou moins avancés, de centrales gaz pouvant être converties à l’hydrogène ou pouvant être équipées d’un système de captage du CO2.
La Pologne est, elle, engagée dans une profonde transformation de son mix. Encore largement dépendante du charbon (56 % de la production d’électricité en 2024), la Pologne mise sur les renouvelables, le nucléaire et le gaz. PGE envisage ainsi de construire 8 GW de nouvelles capacités au gaz. De son côté, ENEA a deux projets immédiats de centrales gaz pour une capacité de 2,5 GW.
Le gaz naturel, une solution intermédiaire qui soulèvent des questions
Le gaz naturel émet deux fois moins de gaz à effet de serre que le charbon pour la production d’électricité. Remplacer le charbon par le gaz, c’est donc déjà faire la moitié du chemin vers la décarbonation. Mais après ? C’est là que l’option du gaz naturel soulève plusieurs questions. La première est d’ordre environnemental. Ces centrales seront responsables d’émissions de gaz à effet de serre et de nombreuses incertitudes pèsent sur la conversion à l’hydrogène. La production d’hydrogène décarboné est aujourd’hui anecdotique et le décollage de ce secteur prend beaucoup de retard. Dans le prolongement, la deuxième question est économique. A ce stade, rien ne dit que la production d’électricité à partir d’hydrogène bas-carbone ou avec captage du CO2 sera compétitive face aux moyens de production naturellement décarbonés. Et si elles doivent continuer à utiliser du gaz naturel, ce sera jusqu’en 2050 au plus tard. Il y a donc un risque que ces centrales se transforment en actifs échoués. Enfin, la dernière question est liée à la souveraineté énergétique. Le fait de miser sur des centrales gaz va à rebours des ambitions d’indépendance énergétique de l’Europe. Rappelons que l’UE (et le Royaume-Uni dans une moindre mesure) est très dépendante de l’extérieur pour ses approvisionnements gaziers. L’an dernier l’UE a importé 90% de sa consommation de gaz.
Si les options sont finalement assez réduites pour ces trois pays et que le gaz répond à plusieurs de leurs problématiques, il s’agit néanmoins d’un pari.